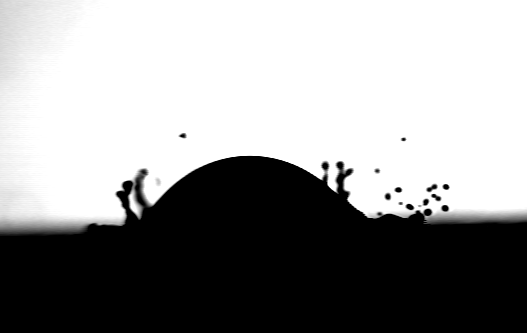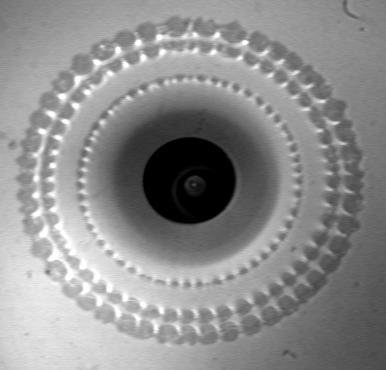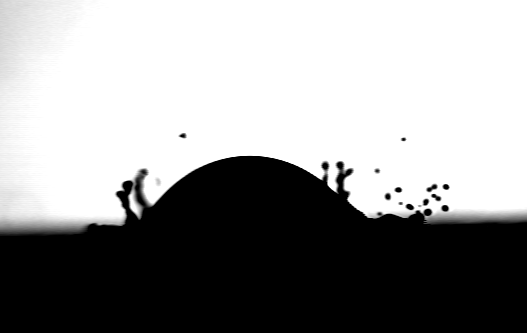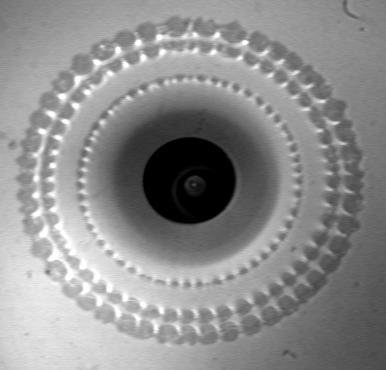LABORATOIRE DE PHYSIQUE THERMIQUE
Unité Mixte de Recherches du C.N.R.S. (UMR
7636)
Pierre PAPON, Professeur à l’E.S.P.C.I.
Madeleine DJABOUROV, Professeur à l’E.S.P.C.I.
Jacques LEBLOND, Professeur à l’E.S.P.C.I.
Hélène ZANNI, Professeur à
l’Université Pierre et Marie Curie
|
TRANSFORMATION DE PHASE DANS
|
LES SOLIDES ET LES FLUIDES |
|
TRANSFORMATIONS DANS LES MATÉRIAUX
|
ÉCOULEMENTS DIPHASIQUES
|
| GELS ET GÉLIFICATION SOUS ÉCOULEMENT
PHYSICO-CHIMIE DES GÉO-MATERIAUX
|
SUSPENSIONS DE PARTICULES ET DE GOUTTES
ÉCOULEMENTS DIPHASIQUES EN CANAL
ÉCOULEMENTS EN MILIEUX POREUX
|
PRÉSENTATION DU LABORATOIRE
-
Transitions de phases dans les solides, les gels , les liquides purs et
les solutions : métastabilité, nucléation, cinétique
de transition de phase et démixtion
-
Rhéologie des gels et des solutions
-
Écoulements diphasiques : suspensions, mélange eau-air
Les recherches actuelles portent,
d’une part, sur les transformations dans des matériaux : prise en
gel sous écoulement, séparation de phases liquide-liquide
en écoulement, cristallisation et prise en gel, prise des ciments
et des bétons, vieillissement des matériaux de construction,
et d’autre part, sur l’écoulement des milieux diphasiques : écoulements
diphasiques eau-air permanents ou intermittents, écoulements diphasiques
air-particules, sédimentation de particules, impact de gouttes.
TRANSFORMATION ET MISE EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX
GELS ET PROCESSUS DE GÉLIFICATION
En présence d’écoulement,
les changements de phases du type gélification, agrégation,
cristallisation ou démixtion, sont fortement perturbés par
la compétition entre les forces hydrodynamiques dues au cisaillement
et les forces attractives responsables de la formation de structures, amas
ou gouttes. Les études menées dans ce vaste domaine tendent
à améliorer les procédés utilisés dans
l'agro-alimentaire, l'industrie pétrolière, ou l'élaboration
de matériaux, en général.
-
Agrégation et gélification sous écoulement ; mise
au point de techniques rhéo-optiques (mesures simultanées
du pouvoir rotatoire, de la biréfringence et des propriétés
rhéologiques).
-
Gélification en présence de démixtion dans les mélanges
protéine-polysaccharide en solutions aqueuses ; diagramme de phase
au repos ; effets du cisaillement sur la structure et les propriétés
mécaniques finales des gels.
-
Élasticité des gels de gélatine d'origines diverses
(mammifères ou poissons) ; recherche d’un comportement universel
reliant propriétés rhéologiques et microstructure
(taux d'hélices).
-
Gels colloïdaux cristallins de paraffines dans les bruts de pétrole.
GÉO-MATÉRIAUX, CIMENTS ET BÉTONS
Dans les matrices cimentaires
des matériaux destinés au génie civil, au chemisage
des puits de pétrole, à l’enrobage et au stockage des déchets
ultimes du nucléaire, les silicates de calcium hydratés,
qui se forment par hydratation des silicates anhydres du ciment ou par
réaction de la chaux avec la fumée de silice contenue dans
les formulations, constituent les « ponts de colle » consolidant
l’ensemble du matériau. Les propriétés mécaniques
finales (résistance et durabilité) dépendent de la
structure des hydrates formés et de la texture de l’ensemble consolidé.
Différentes techniques de Résonance Magnétique Nucléaire
sont utilisées pour étudier :
-
la structure des hydrates en fonction des conditions de leur formation
(pression, température, compacité de la matrice anhydre)
-
la texture des bétons via la mesure de la porosité
-
l’évolution de la structure et de la texture lors de la lixiviation
des matériaux , en liaison avec leur durabilité.
Parallèlement à
ces études, d’autres mécanismes de dégradation sont
analysés :
-
La réaction alcali silice qui, en générant des gels
gonflants, conduit à un endommagement des bétons, abordée
en étudiant l’expansion de gels silico-alumineux en présence
de solutions ioniques
-
La dégradation des bétons par l’environnement, abordée
en étudiant l’invasion d’un milieu poreux modèle par les
constituants d’une solution réactive.
Enfin l’optimisation de la tenue
mécanique des structures enchevêtrées est analysée
en étudiant la tenue à la traction de milieux constitués
de particules minérales fibreuses.
ÉCOULEMENTS DIPHASIQUES
PARTICULES DANS UN FLUIDE VISQUEUX
La sédimentation
de particules dépend des interactions hydrodynamiques entre elles
et aussi avec les parois du récipient. A l'échelle de quelques
particules, les interactions peuvent être calculées. Le mouvement
d'une particule est aussi mesuré par interférométrie
laser. À l'échelle d'un nuage de particules, une théorie
statistique est nécessaire. La structure de la suspension est mesurée
avec une nouvelle technique de RMN analogue à la diffraction de
la lumière.
En général, les fluides visqueux ne glissent pas sur
les solides. Mais une théorie applicable aux surfaces hydrophobes
utilise une condition de glissement pour rendre compte d'effets observés
au microscope à force atomique.
L'inertie du fluide donne des forces de portance sur les particules.
Cette théorie s'applique aux méthodes de séparation
de type "fractionnement flux force".
DYNAMIQUE ET THERMIQUE DES GOUTTES
L'histogramme d'un nuage
évolue par les collisions entre gouttes. Le calcul des écoulements
à l'extérieur et à l'intérieur des gouttes
détermine la vitesse d'approche avant collision. La prédiction
de la formation de grosses gouttes est importante pour les aéronefs
car de grosses gouttes en surfusion peuvent se congeler à leur contact.
Ces conditions sont simulées dans des souffleries à givrage.
Une technique de fluorescence induite par laser est mise au point pour
mesurer la température des gouttes en vol.
A température ambiante,
une goutte qui heurte une surface sèche peut s'étaler ou
éclater suivant la rugosité de la surface (voir figures),
sa mouillabilité,... Ceci s'applique à l'aéronautique,
l'industrie automobile et l'agriculture. En dessous du point de congélation,
l'impact peut créer différents types de givre.
ÉCOULEMENTS DIPHASIQUES EN CANAL
L’étude des écoulements
diphasiques eau-air stationnaires ou intermittents est abordée ici
à l’aide de techniques dérivées de PFGSE-NMR1.
-
Écoulement intermittent en canal vertical ; ce type d’écoulement,
caractérisé par le passage pseudo-périodique de poches
d’air et de régions diphasiques à bulles (bouchons) est observé
lors du transfert du brut de pétrole ou lors du fonctionnement accidentel
des circuits de refroidissement (nucléaire). Les interactions entre
poches, résultent de deux mécanismes : - les échanges
d’air entre les poches et les bouchons, - les interactions hydrodynamiques
entre poches successives. L’objectif est de comprendre les mécanismes
d’évolution de ce type d’écoulement et d’établir leurs
conditions de stabilité.
-
Fluctuations de flux de masse et de quantité de mouvement dans les
écoulements à bulles ; la connaissance de ces fluctuations
est fondamentale pour comprendre les interactions écoulement-structure
dans les générateurs de vapeur.
-
"Flashing" durant une dépressurisation rapide ; l’effet des différents
types de nucléation est prise en compte pour modéliser les
conditions de dépressurisation accidentelle d’une canalisation contenant
de l’eau à température élevée.
ÉCOULEMENTS EN MILIEUX POREUX
La compréhension
complète du transport en milieu poreux requiert une caractérisation
des mécanismes de transport à l’échelle des pores
et l’étude des contributions de la convection, de la diffusion
moléculaire et de la dispersion. Les caractéristiques de
transport sont obtenues en comparant les résultats des analyses
par PFGSE-NMR (séquence d’écho de spin en présence
d’impulsions de gradient de champ magnétique) avec ceux issus des
simulations numériques. L’analyse du transport sur différentes
échelles permet, de caractériser les formes et les tailles
des pores et de leurs connections, et de mettre en évidence les
effets d’inertie. En transport diphasique (eau-huile, par exemple), les
propriétés de chacune des phases (taux de saturation et transport)
peuvent ainsi être caractérisées.
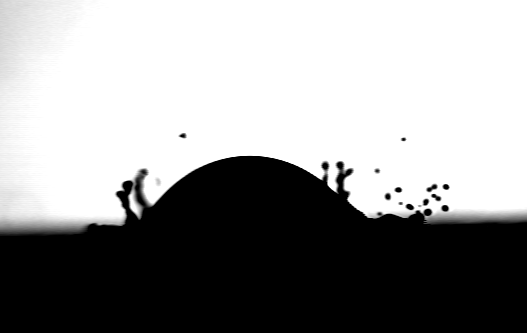 Figure 1. Impact d'une goutte d'eau de 3,8 mm de diamètre sur une
plaque de Plexiglas rainurée par des sillons à profil
triangulaire, distants de 0,5 mm. Prise de vue de côté,
perpendiculaire aux rainures.
Figure 1. Impact d'une goutte d'eau de 3,8 mm de diamètre sur une
plaque de Plexiglas rainurée par des sillons à profil
triangulaire, distants de 0,5 mm. Prise de vue de côté,
perpendiculaire aux rainures. |
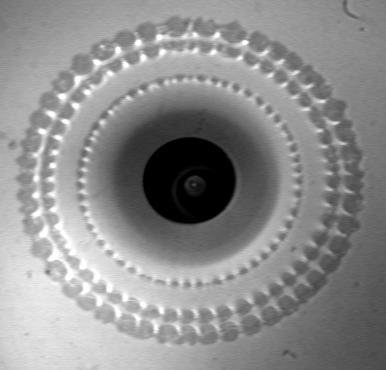 Figure 2. Impact d'une goutte d'eau de 3,8 mm de diamètre sur une
plaque de verre lisse. 5 vues de dessous superposées espacées
de 0,66 ms.
Figure 2. Impact d'une goutte d'eau de 3,8 mm de diamètre sur une
plaque de verre lisse. 5 vues de dessous superposées espacées
de 0,66 ms. |
STRUCTURE DU LABORATOIRE
Chercheurs : 8
Étudiants en thèses : 8
Post-doc : 4
Stages de DEA : 4
Ingénieurs, techniciens, administratifs : 4 |
PUBLICATIONS (1996-2000)
Publications écrites et orales : 110
Thèses : 9
CONTRATS
¼ par crédits de base ; ¾ par contrats
2 contrats européens FAIR (coordinateurs Unilever (Pays-Bas)
et Icetec (Islande), 1 contrat européen Unicorn (coordinateur
Bouygues BTP), CNRS-ATILH (matériaux), GREDIC (CNRS, MENESR, CEA,
EDF), CNES, MENESR, METL, ELF EP, IFP, ONERA, Lafarge, Ciments Français-Italcimenti,
Solétanche-Bachy, DGA/CEPr, ANDRA, CEA/Cadarache.. |
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
RMN haute résolution du solide (100, 300 et 500 MHz)
RMN bas champ (5 MHz)
Rhéomètres à contrainte imposée
Système rhéo-optique
Spectromètre pour diffusion quasiélastique de la lumière
Spectromètre pour diffusion statique de la lumière
Polarimètre automatique
Caméra rapide
|